
Qu’avez-vous ressenti en recevant le Prix 2025 de la traduction de documentaires audiovisuels ?
Le Prix ATAA est une reconnaissance du métier. Mon plus grand plaisir est qu’il m’ait été remis par mes pair.es. J’avoue que c’est un sentiment très agréable, celui de faire partie d’une profession, d’un corps de métier… Parce que l’adaptation est une activité souvent mal comprise de notre entourage.
Outre la traduction, l’écriture est au cœur du métier d’adaptateurice. Qu’en est-il vous concernant ?
J’ai une passion pour l’art du récit. Depuis toujours, je suis fascinée par le son, les voix, les langues. C’est dans cette approche que j’écris des histoires et des scénarios pour des spectacles de mapping monumental [fresque vidéo projetée sur des monuments, ndlr], souvent à destination du jeune public. Pour ces projets, outre le texte, je m’occupe entièrement de la bande-son : voix, bruitages, choix des musiques… Pour moi, le son est comme une langue, et je le travaille comme on travaille avec des mots. Cette activité se rapproche du métier de sound designer, et se pratique en collaboration avec les ingénieur.es du son en charge du mixage. Parmi mes autres collaborations, j’ai aussi co-écrit et co-réalisé un documentaire sur Jacques Trovic, un artiste d’art brut, qui a reçu le prix spécial du jury du festival Mifac [Marché International du Film sur les Artistes Contemporains, ndlr] en 2024. Néanmoins, je dédie en moyenne 80 % de mon temps à l’adaptation audiovisuelle.
Audiovisuel, spectacles, édition, musées… Vos activités sont éclectiques. D’où vient cette diversité ?
Même si cela peut sembler éclectique, le fil rouge de mes activités demeure l’articulation sons/mots/images, ainsi que l’art de raconter des histoires. J’ai commencé ma carrière comme conseillère littéraire pour des théâtres nationaux. Initialement, j’ai suivi une formation classique : hypokhâgne-khâgne, suivies de longues études en Lettres, Histoire et Sciences du langage, menées conjointement, parce que je ne voulais pas choisir. En parallèle, je fréquentais une école de théâtre.
À l’époque, je sentais déjà une très grande imperméabilité entre les activités, comme si l’on était sommés de choisir son camp, d’être immédiatement identifiable. C’est peut-être pour cette raison que, quelques années plus tard, je suis partie vivre à l’étranger. Grâce à ma formation de comédienne, j’ai continué de jouer, notamment en doublage, et grâce à ma formation littéraire, j’ai découvert la traduction puis l’adaptation. Alors qu’en partant loin j’avais le sentiment de pouvoir faire table rase, j’ai au contraire mobilisé mes différents centres d’intérêt et compétences. Dans ce nouveau cadre, j’ai découvert l’univers du son et des studios, le doublage, la voix-off et la voice over. J’ai réalisé que cela rassemblait tout ce que je savais faire. La rencontre de ces différentes activités me permettait de travailler à la fois dans l’univers sonore et celui de l’écriture. D’un coup, tout trouvait sens.
À mon retour en France, j’ai conservé mon réseau littéraire et continué à traduire pour des musées et institutions de différents pays comme la Tate Gallery ou la fondation Gala-Salvador Dalí. Et je me suis consacrée pleinement à l’adaptation.
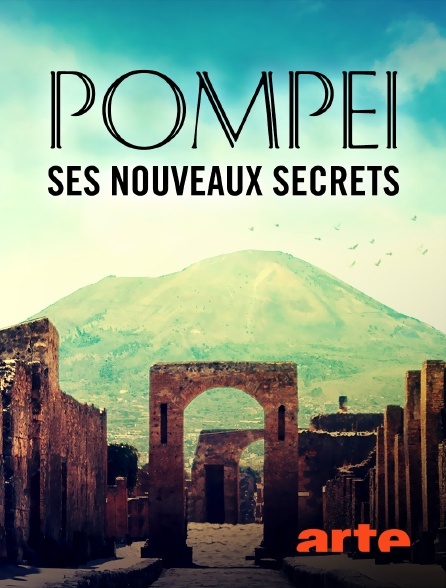
Quel est votre meilleur souvenir d’adaptation ?
Je me suis évidemment passionnée pour certains des programmes que l’on m’a confiés. Mais plus importante encore est la collaboration avec mes binômes. J’aime les compagnonnages efficaces : véritablement, ce sont mes meilleurs souvenirs professionnels. J’aime cette sensation d’avoir réalisé un travail collectif, une œuvre commune… Personnellement, même si l’outil est essentiel, je n’aime pas travailler uniquement avec les bibles : je préfère décrocher mon téléphone et échanger avec une consœur ou un confrère. Quand on parle, on réfléchit simultanément : c’est souvent au cours d’une conversation que les choses se dénouent et que l’on comprend mieux l’enjeu d’un dialogue ou d’une scène. Cela permet d’échanger sur la manière dont nous percevons les personnages. Selon moi, ce n’est jamais du temps perdu.
Beaucoup d’adaptateurs préfèrent la fiction car cette dernière s’avère mieux rémunérée et davantage valorisée par la profession. Dans ce contexte, pourquoi avoir souhaité revenir au documentaire ?
Pour un même calibrage de texte, une adaptation en doublage me demande le double de temps. Me concernant, la fiction ne se révèle donc pas plus rémunératrice. Peut-être que certain.es auteurices travaillent plus vite, mais moi, j’en suis incapable. Même si j’adore l’écriture de dialogues, je trouve que le documentaire se rapproche davantage du récit. J’ai plus fortement le sentiment de raconter une histoire. Quand on adapte pour le doublage sur logiciel (comme Mosaic), on a tendance à penser phrase par phrase, unité par unité. On le sait, on essaie d’y être attentif au fil du travail, mais immanquablement, quand on se relit « à plat », le manque de liant saute aux yeux. Évidemment, on reprend tout, on corrige. Mais c’est une contrainte qui s’avère parfois « douloureuse ». C’est pour cette raison que j’ai souhaité revenir au documentaire. Je m’y sens plus libre. Aujourd’hui mon activité se répartit à moitié entre le documentaire et la fiction. Et même si je n’ai aucune stratégie concernant ma rémunération, les droits d’auteur, non négligeables en documentaire, permettent de rééquilibrer la rémunération à la racine et m’offrent plus de sérénité.
Quelle est votre expérience de l’intelligence artificielle ?
Un musée m’a sollicitée pour revoir une traduction réalisée par intelligence artificielle. Cette mission consistait à relire un millier de cartels de pièces archéologiques. La traduction s’est avérée de mauvaise qualité. Sans l’objet sous les yeux, cet exercice est impossible. Cependant, la conservatrice est tombée des nues quand je lui ai fait part de mes réserves. Elle considérait que dans ce genre de cas, un mot de la langue source avait son exact équivalent dans la langue cible et que ce travail pouvait donc relever des compétences de l’IA. Critiquer cette traduction m’a mise dans une position inconfortable, car je ne voulais pas paraître opportuniste… Néanmoins, mon client (peut-être parce que nous avions souvent travaillé ensemble) a suivi mon conseil et m’a demandé de retraduire ex nihilo les contenus.

Qu’est-ce qui vous nourrit intellectuellement ?
Les activités qui ne sont pas intellectuelles. J’ai une passion pour les jardins et pour la cuisine. Je ne connais pas de meilleur remède à un blocage sur une phrase que d’aller mettre les mains dans la terre ou dans la farine. Par ailleurs, j’ai un goût insatiable pour le langage et les sons. La beauté de certaines phrases, le grain de certaines voix peuvent provoquer en moi de très grandes émotions. J’adore les voix radiophoniques ; sur mon temps libre, j’écoute inlassablement la radio ou des podcasts. Par ailleurs, je lis beaucoup : chaque matin, avec ma première tasse de café, je consacre une heure à la lecture. Depuis que mes enfants sont grands, les premières heures du matin m’appartiennent de nouveau. Mes lectures sont extrêmement variées. Comme dit précédemment, j’ai du mal avec le « cloisonnement ». Je peux autant me délecter d’un texte de La Bruyère, écrit au cordeau, que me passionner pour un auteur contemporain comme Nicolas Mathieu, ou pour un ouvrage scientifique, un manuel de jardinage, ou encore un polar dont le récit va me captiver.
Votre mot de la fin ?
Quand je suis sollicitée par des étudiants pour des conseils sur le métier, je les entends souvent revendiquer leur bilinguisme en japonais, en anglais ou toute autre langue. Je leur réponds toujours que l’essentiel, pour l’exercice de cette profession, est leur maîtrise de la langue française, dans tous ses registres, et qu’il est incontournable qu’iels fassent rentrer dans leur oreille des voix de comédiens, qu’ils fréquentent les théâtres, mais aussi qu’iels regardent des films, des téléfilms français et écoutent comment jouent les comédiens et comment les gens parlent, dans différents contextes, pour acquérir la maîtrise de la langue.
Crédit photo : Brett Walsh
